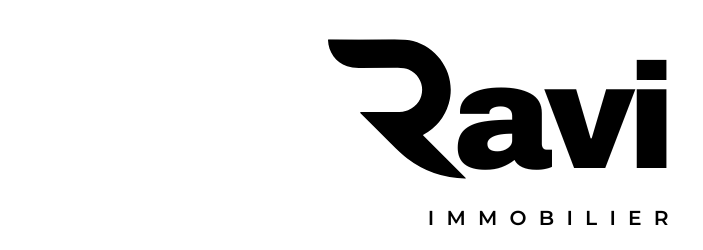En France, la rénovation énergétique des bâtiments représente un enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique. Avec 17 millions de passoires thermiques identifiées sur le territoire, les dispositifs d’aide se multiplient mais restent sous-utilisés. Malgré une volonté politique affichée et des budgets conséquents, seulement 15% des ménages éligibles sollicitent effectivement ces aides. Ce paradoxe s’explique par un système complexe, des procédures administratives lourdes et un manque d’accompagnement personnalisé. Alors que la transition énergétique s’accélère, le déverrouillage de ces mécanismes de soutien devient une priorité absolue pour atteindre les objectifs climatiques nationaux.
Le labyrinthe administratif des aides à la rénovation énergétique
La France dispose aujourd’hui d’un arsenal impressionnant de dispositifs pour soutenir la rénovation énergétique des logements. MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro, TVA réduite, certificats d’économies d’énergie ou encore aides des collectivités locales forment un écosystème de financement théoriquement robuste. Pourtant, cette multiplicité crée un véritable dédale administratif pour les particuliers.
D’après une étude de l’ADEME publiée en 2023, 68% des Français considèrent que la complexité administrative constitue le frein principal à l’utilisation des aides disponibles. Cette perception n’est pas infondée : pour un projet de rénovation global, un propriétaire doit souvent constituer jusqu’à cinq dossiers distincts, auprès d’organismes différents, avec des critères d’éligibilité variables et des calendriers de demande spécifiques.
Le parcours utilisateur s’apparente à un marathon bureaucratique. Prenons l’exemple d’un ménage souhaitant remplacer sa chaudière et isoler ses combles : il devra d’abord déterminer son éligibilité à MaPrimeRénov’ selon ses revenus, puis monter un dossier incluant des devis normalisés, justifier de la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) de l’artisan choisi, avant de solliciter parallèlement des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) auprès d’un fournisseur d’énergie, tout en vérifiant s’il peut bénéficier d’aides locales.
La fragmentation des guichets d’information accentue cette difficulté. Malgré la création du réseau France Rénov’ en 2022, censé centraliser l’information, la coordination entre les différents acteurs reste insuffisante. Selon un rapport de la Cour des Comptes de février 2023, « l’éclatement des sources d’information et l’absence d’outil numérique unifié complique considérablement l’accès aux aides pour les ménages les moins avertis ».
Cette complexité génère des inégalités sociales face à l’accès aux aides. Les ménages les plus favorisés, disposant de compétences administratives et numériques, parviennent à naviguer dans ce système, tandis que les plus modestes, pourtant prioritaires dans les politiques publiques, se retrouvent souvent exclus par défaut. Un paradoxe souligné par la Fondation Abbé Pierre qui note que « les aides bénéficient insuffisamment à ceux qui en ont le plus besoin ».
Face à cette situation, des initiatives émergent pour simplifier les démarches. Le tiers-financement, porté par des sociétés régionales comme Île-de-France Énergies ou Oktave dans le Grand Est, propose une approche intégrée où un seul interlocuteur gère l’ensemble des demandes d’aides. Néanmoins, ces structures restent limitées géographiquement et ne couvrent pas l’ensemble du territoire national.
Des délais qui découragent l’action
Au-delà de la complexité, les délais de traitement constituent un autre obstacle majeur. Pour MaPrimeRénov’, le temps moyen entre le dépôt du dossier et le versement effectif de l’aide atteignait 6 mois en 2022, selon les chiffres de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). Cette attente peut mettre en difficulté financière de nombreux ménages qui doivent avancer les frais.
- Délai moyen d’instruction des dossiers MaPrimeRénov’ : 2 à 3 mois
- Délai de paiement après validation : 2 à 4 mois
- Taux de dossiers incomplets nécessitant des compléments : 42%
La simplification administrative représente donc un enjeu central pour démocratiser l’accès aux rénovations énergétiques et accélérer la transition écologique du parc immobilier français.
Le déficit d’information et d’accompagnement technique
Au-delà des obstacles administratifs, un second défi majeur se dresse sur la route des rénovations énergétiques : le manque d’information claire et d’accompagnement technique adapté. Malgré l’existence de dispositifs comme France Rénov’, l’information reste dispersée et souvent technique, créant un sentiment d’insécurité chez les ménages désireux d’entreprendre des travaux.
Une enquête OpinionWay réalisée pour le compte de Hellio en 2023 révèle que 72% des propriétaires se disent mal informés sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Plus préoccupant encore, 58% des répondants indiquent ne pas savoir par où commencer leur projet de rénovation. Cette méconnaissance génère une forme d’autocensure : de nombreux ménages renoncent à leurs projets avant même d’avoir exploré les possibilités de financement.
Le parcours de rénovation soulève des questions techniques complexes que peu de particuliers maîtrisent. Quelle est la solution d’isolation la plus adaptée à mon logement ? Dois-je privilégier le changement de mon système de chauffage ou l’isolation de mon enveloppe ? Comment séquencer les travaux de manière optimale ? Ces interrogations légitimes nécessitent des réponses personnalisées que les plateformes d’information généralistes ne peuvent fournir.
L’accompagnement technique constitue donc un maillon essentiel mais souvent manquant. Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’, lancé en 2023 pour remédier à cette lacune, peine à se déployer à grande échelle. Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, seulement 2 500 accompagnateurs étaient opérationnels fin 2023, un nombre insuffisant face aux besoins estimés à 20 000 pour couvrir l’ensemble du territoire.
Cette pénurie d’experts qualifiés s’explique notamment par un modèle économique fragile. La Fédération FAIRE, qui regroupe ces professionnels, alerte sur le manque de visibilité financière : « Le financement de l’accompagnement reste précaire, avec des subventions annuelles qui ne permettent pas d’investir dans la durée et de recruter les compétences nécessaires ».
Les conséquences de ce déficit d’accompagnement sont multiples. D’abord, il favorise les rénovations par geste unique plutôt que les approches globales, plus efficaces énergétiquement. Ensuite, il laisse le champ libre aux pratiques commerciales agressives et aux arnaques, qui ont touché plus de 15% des ménages ayant réalisé des travaux en 2022 selon la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes).
Des outils numériques encore insuffisants
Le numérique, qui pourrait constituer un levier puissant de démocratisation de l’information, montre ses limites actuelles. Si plusieurs simulateurs d’aides existent (comme Simul’Aid€s), ils restent souvent incomplets ou trop complexes pour des utilisateurs non-initiés. L’étude Capgemini Research Institute de 2023 sur la maturité numérique des services publics place les outils liés à la rénovation énergétique parmi les moins ergonomiques, avec un taux d’abandon des démarches en ligne de 41%.
Dans ce contexte, certaines initiatives privées tentent de combler le vide. Des plateformes comme Heero ou Effy proposent un accompagnement numérique simplifié, mais leur modèle économique, souvent basé sur la captation des CEE, suscite des questions sur l’indépendance des conseils prodigués.
- Taux de ménages estimant manquer d’informations sur les aides : 72%
- Proportion de propriétaires ne sachant pas par où commencer : 58%
- Nombre d’accompagnateurs Rénov’ disponibles : 2 500 (besoin estimé : 20 000)
L’amélioration de l’information et de l’accompagnement technique représente donc un levier fondamental pour débloquer le potentiel des rénovations énergétiques en France.
Les barrières financières persistantes
Malgré la multiplication des dispositifs d’aide, le frein financier demeure un obstacle majeur pour de nombreux ménages français. Si l’effort budgétaire public est considérable – avec près de 4 milliards d’euros alloués à MaPrimeRénov’ en 2023 – le reste à charge pour les particuliers reste souvent prohibitif, particulièrement pour les rénovations globales performantes.
Une rénovation énergétique complète d’un logement de 100m² coûte en moyenne entre 40 000 et 70 000 euros selon les données de la DHUP (Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages). Même en cumulant l’ensemble des aides disponibles, le reste à charge peut représenter 40 à 60% du montant total, soit 20 000 à 40 000 euros. Une somme considérable pour la majorité des ménages français, dont l’épargne moyenne disponible s’élève à 16 000 euros d’après les chiffres de la Banque de France.
Cette réalité financière crée un effet ciseau particulièrement problématique : les ménages les plus modestes, qui vivent souvent dans les logements les plus énergivores, sont aussi ceux qui disposent des capacités financières les plus limitées pour engager des travaux. Le taux d’effort (part du budget consacré au logement) déjà élevé pour ces ménages rend difficile tout investissement supplémentaire, même avec la perspective d’économies futures sur les factures énergétiques.
Le préfinancement des aides constitue une difficulté supplémentaire. La plupart des dispositifs fonctionnent sur le principe du remboursement après travaux, ce qui implique d’avancer des sommes considérables. Selon une étude de l’Institut négaWatt, cette contrainte exclut de facto près de 40% des ménages éligibles, qui ne peuvent mobiliser la trésorerie nécessaire.
Les solutions de financement complémentaires restent insuffisamment développées. L’éco-prêt à taux zéro, théoriquement attractif, se heurte à la frilosité des banques : seulement 35 000 prêts ont été distribués en 2022, loin de l’objectif initial de 100 000. Les raisons invoquées par les établissements bancaires incluent la complexité administrative du dispositif et sa faible rentabilité.
Des aides mal calibrées pour les rénovations performantes
Le système actuel d’aides présente un biais structurel en faveur des rénovations par geste unique (changement de chaudière, isolation des combles…) au détriment des rénovations globales performantes. MaPrimeRénov’ finance majoritairement des travaux mono-geste, qui représentaient 92% des dossiers en 2022 selon l’ANAH.
Or, ces interventions ponctuelles, si elles permettent des gains énergétiques rapides, peuvent créer des situations de « lock-in » technologique, où des travaux partiels mal séquencés compromettent la possibilité d’atteindre à terme une haute performance énergétique. Le CLER (Réseau pour la transition énergétique) alerte sur ce risque : « Nous créons aujourd’hui les passoires thermiques de demain en finançant massivement des rénovations partielles non coordonnées ».
Le dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité, destiné aux rénovations globales, reste sous-dimensionné avec seulement 40 000 logements rénovés en 2022, quand l’objectif national fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone nécessiterait d’atteindre 700 000 rénovations performantes annuelles d’ici 2030.
- Coût moyen d’une rénovation globale : 40 000 à 70 000 €
- Reste à charge moyen après aides : 20 000 à 40 000 €
- Proportion de ménages exclus par l’impossibilité de préfinancement : 40%
- Part des rénovations mono-geste dans les dossiers MaPrimeRénov’ : 92%
Le défi financier appelle donc une refonte profonde des mécanismes d’aide, privilégiant le préfinancement, l’accompagnement des ménages modestes et l’orientation vers des rénovations globales performantes.
Les disparités territoriales dans l’accès aux aides
La France présente une mosaïque territoriale en matière d’accès aux dispositifs de soutien à la rénovation énergétique. Des écarts significatifs s’observent entre zones urbaines et rurales, entre métropoles et petites villes, créant une forme de fracture territoriale qui freine la dynamique nationale de rénovation.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon l’ONRE (Observatoire National de la Rénovation Énergétique), le taux de pénétration de MaPrimeRénov’ varie de 1 à 5 entre les départements les plus actifs et les moins engagés. En 2022, la Vendée ou le Finistère affichaient des taux de mobilisation supérieurs à 15 dossiers pour 1000 logements, quand des départements comme les Bouches-du-Rhône ou la Seine-Saint-Denis plafonnaient à moins de 3 dossiers pour 1000 logements.
Cette hétérogénéité s’explique par plusieurs facteurs structurels. En premier lieu, la couverture inégale du territoire par les services d’accompagnement. Le réseau France Rénov’ compte environ 450 espaces conseil, mais leur répartition géographique reste déséquilibrée. Dans les zones rurales, certains ménages doivent parcourir plus de 50 kilomètres pour rencontrer un conseiller, ce qui constitue un frein réel à l’engagement dans un projet de rénovation.
La fracture numérique accentue ces disparités. Alors que les démarches de demande d’aide se dématérialisent progressivement, 13 millions de Français restent éloignés du numérique selon l’INSEE. Dans les territoires ruraux, où le taux d’illectronisme peut atteindre 30% de la population, cette situation crée une double peine : éloignement des services physiques et difficultés d’accès aux alternatives numériques.
Le dynamisme économique local joue également un rôle déterminant. La disponibilité d’artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) varie considérablement selon les territoires. Une étude de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) révèle que dans certains départements ruraux, on compte moins de 5 artisans RGE pour 10 000 habitants, contre plus de 15 dans les zones périurbaines dynamiques.
Le rôle décisif des collectivités locales
Face à ces disparités, les collectivités territoriales jouent un rôle de plus en plus central pour compenser les lacunes du système national. Certaines régions, comme la Nouvelle-Aquitaine ou l’Occitanie, ont développé des politiques ambitieuses complétant les dispositifs nationaux. Le programme Rénov’Occitanie, par exemple, propose un service d’accompagnement renforcé avec audit énergétique subventionné et solutions de tiers-financement.
Au niveau des intercommunalités, les PTRE (Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique) constituent des outils efficaces pour adapter l’offre d’accompagnement aux spécificités locales. Des initiatives comme DOREMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles) dans la Drôme ou Oktave dans le Grand Est démontrent l’efficacité d’approches territorialisées, mobilisant les artisans locaux et proposant un accompagnement de proximité.
Cependant, toutes les collectivités ne disposent pas des mêmes moyens humains et financiers pour déployer de tels dispositifs. Les métropoles et grandes agglomérations peuvent mobiliser des ressources conséquentes, tandis que les territoires ruraux ou en déclin démographique peinent à structurer une offre comparable. Cette situation crée un cercle vicieux où les territoires les moins dotés en ingénierie sont aussi ceux qui captent le moins de financements nationaux.
La coordination entre les différents échelons de collectivités reste perfectible. Un rapport de l’AdCF (Assemblée des Communautés de France) pointe « l’empilement des dispositifs locaux » qui, paradoxalement, peut recréer à l’échelle territoriale la complexité observée au niveau national. Des ménages situés à quelques kilomètres de distance peuvent ainsi se voir proposer des aides et un accompagnement radicalement différents selon leur commune de résidence.
- Écart de mobilisation de MaPrimeRénov’ entre départements : de 1 à 5
- Distance moyenne à un espace France Rénov’ en zone rurale : > 30 km
- Taux d’illectronisme dans certains territoires ruraux : jusqu’à 30%
- Densité d’artisans RGE : de 5 à 15 pour 10 000 habitants selon les territoires
L’harmonisation territoriale de l’accès aux aides constitue donc un enjeu majeur pour garantir l’équité entre citoyens face à la transition énergétique et maximiser l’impact des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national.
Vers un nouveau modèle de financement et d’accompagnement
Face aux obstacles persistants, une refonte profonde des mécanismes de soutien à la rénovation énergétique s’impose. L’enjeu n’est plus seulement d’augmenter les budgets alloués, mais de repenser l’architecture même du système pour le rendre plus accessible, plus équitable et plus efficace énergétiquement.
Plusieurs pistes innovantes émergent en France et à l’étranger, dessinant les contours d’un modèle alternatif. La première consiste à simplifier radicalement le parcours administratif par la création d’un guichet unique véritable. Au-delà du réseau France Rénov’, qui constitue une avancée mais reste principalement informationnel, il s’agirait d’instaurer un interlocuteur unique gérant l’ensemble des démarches administratives pour le compte du ménage.
La Région Île-de-France expérimente depuis 2021 cette approche avec sa plateforme Île-de-France Énergies, qui centralise l’ensemble des demandes d’aides et propose un parcours intégré, de l’audit énergétique jusqu’au suivi post-travaux. Les premiers résultats sont encourageants avec un taux de transformation des contacts en travaux de 35%, contre moins de 10% dans le système classique.
Le préfinancement des aides constitue une seconde innovation majeure. Inspiré du modèle allemand de la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), ce système permettrait de verser les subventions directement aux artisans ou à un tiers de confiance, évitant aux ménages d’avancer des sommes importantes. Certaines collectivités pionnières comme Bordeaux Métropole ou la Région Grand Est expérimentent déjà ce mécanisme à travers leurs sociétés de tiers-financement.
L’évolution vers une logique de résultat plutôt que de moyens représente une troisième voie prometteuse. Actuellement, les aides sont conditionnées au respect de critères techniques (matériaux utilisés, équipements installés) sans garantie de performance réelle. Un système basé sur les économies d’énergie effectivement réalisées, mesuré par exemple par la différence de consommation avant/après travaux, inciterait à la qualité des interventions et à une approche globale de la rénovation.
S’inspirer des modèles étrangers qui fonctionnent
Plusieurs pays européens ont développé des approches innovantes dont la France pourrait s’inspirer. Les Pays-Bas ont mis en place un système de « passeport de rénovation » (Woningabonnement), document unique qui suit le logement tout au long de sa vie et programme les étapes de sa rénovation progressive jusqu’à l’atteinte d’un niveau zéro énergie.
En Allemagne, la banque publique KfW propose un modèle intégré combinant subventions et prêts bonifiés, avec un accompagnement technique obligatoire. Le système repose sur une logique de performance globale avec des niveaux d’aide croissants selon l’ambition énergétique du projet. En 2022, ce dispositif a permis de rénover 340 000 logements au standard BBC (Bâtiment Basse Consommation) ou supérieur.
La Belgique, à travers le programme RENOWATT en Wallonie, a développé une approche innovante basée sur les CPE (Contrats de Performance Énergétique). Ce mécanisme garantit contractuellement au propriétaire un niveau d’économies d’énergie après travaux, avec des pénalités pour l’entreprise si les objectifs ne sont pas atteints.
Repenser le financement sur le temps long
Le modèle économique des rénovations énergétiques doit intégrer une vision à long terme, en phase avec la durée de vie des bâtiments et les bénéfices durables générés. Le développement de mécanismes de financement attachés au logement plutôt qu’à son propriétaire constitue une piste prometteuse.
Le PAE (Prêt Avance Rénovation), créé par la loi Climat et Résilience, permet de reporter tout ou partie du remboursement d’un prêt à la revente du bien ou à la succession. Ce mécanisme, encore peu déployé (moins de 1 000 prêts distribués en 2022), pourrait lever l’obstacle du retour sur investissement, particulièrement pour les propriétaires âgés.
Plus ambitieuse encore, l’idée d’un CARRE (Crédit d’impôt Acquisition-Rénovation Remboursable par l’Énergie), portée par le Plan Bâtiment Durable, vise à créer un prêt remboursé par les économies d’énergie réalisées, avec un mécanisme de tiers-payant permettant de neutraliser l’impact sur le budget des ménages.
- Taux de transformation des contacts en travaux (modèle guichet unique) : 35%
- Nombre de logements rénovés au standard BBC en Allemagne (2022) : 340 000
- Économies d’énergie garanties par les CPE belges : 30 à 50%
- Nombre de PAE (Prêt Avance Rénovation) distribués en France (2022) : < 1 000
La transition vers ce nouveau modèle nécessite un engagement politique fort et une vision de long terme, dépassant les logiques de court terme qui ont jusqu’ici prévalu dans la conception des politiques publiques de rénovation énergétique.
Un impératif pour l’avenir : transformer l’essai collectif
Débloquer l’accès aux aides à la rénovation énergétique n’est plus seulement un enjeu technique ou administratif : c’est devenu un impératif social, économique et environnemental pour la France. Avec l’accélération du changement climatique et la hausse structurelle des prix de l’énergie, la transformation du parc immobilier français constitue une urgence collective qui ne peut plus souffrir de demi-mesures.
Les chiffres illustrent l’ampleur du défi : pour atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone, la France devrait rénover 700 000 logements par an au niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) d’ici 2030, puis 1 million par an entre 2030 et 2050. Or, le rythme actuel plafonne à environ 70 000 rénovations performantes annuelles, soit dix fois moins que nécessaire.
Cette accélération massive requiert une mobilisation sans précédent des acteurs publics et privés. Le secteur bancaire, encore trop timide, doit devenir un partenaire central de cette transition. Les établissements financiers disposent à la fois de la capacité de distribution et de l’expertise financière pour concevoir des produits adaptés à la rénovation énergétique. Des expérimentations comme celle du Crédit Agricole en Bretagne, qui propose un « prêt rénovation » avec différé d’amortissement calé sur les économies d’énergie, montrent la voie.
La formation représente un autre levier stratégique. Le manque de professionnels qualifiés constitue aujourd’hui un goulot d’étranglement majeur. Selon la FFB (Fédération Française du Bâtiment), le secteur de la rénovation énergétique pourrait créer jusqu’à 200 000 emplois d’ici 2030, à condition d’investir massivement dans la formation initiale et continue. Des initiatives comme le programme FEEBAT (Formation aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment) doivent être amplifiées et complétées par des formations spécifiques aux rénovations globales performantes.
L’innovation technologique offre des perspectives prometteuses pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité des rénovations. La rénovation industrialisée, développée notamment aux Pays-Bas avec le programme Energiesprong, permet de diviser par deux les délais de chantier et d’améliorer significativement la qualité des réalisations. En France, des expérimentations sont en cours dans plusieurs régions, comme en Auvergne-Rhône-Alpes avec le projet MURE (Méthode Universelle de Rénovation Énergétique).
L’enjeu de la justice sociale
La dimension sociale de la rénovation énergétique ne peut être négligée. La lutte contre la précarité énergétique, qui touche près de 12 millions de Français selon l’Observatoire National de la Précarité Énergétique, doit constituer une priorité absolue. Les ménages modestes, souvent locataires de passoires thermiques, subissent une double peine : factures énergétiques élevées et difficultés d’accès aux dispositifs d’amélioration.
Pour ces populations vulnérables, des approches spécifiques doivent être développées. Le programme Habiter Mieux de l’ANAH, rebaptisé MaPrimeRénov’ Sérénité, propose un accompagnement renforcé et des taux de subvention pouvant atteindre 90% pour les ménages très modestes. Néanmoins, sa portée reste limitée avec environ 40 000 logements rénovés annuellement.
Le parc locatif privé constitue un angle mort particulièrement problématique. Malgré l’interdiction progressive de location des passoires thermiques prévue par la loi Climat et Résilience, les mécanismes incitatifs pour les propriétaires bailleurs restent insuffisants. Le développement de solutions comme le tiers-financement avec partage des économies entre propriétaire et locataire pourrait débloquer cette situation.
Un nouveau pacte entre citoyens et pouvoirs publics
Au-delà des aspects techniques et financiers, la réussite de la transition énergétique du parc immobilier français repose sur un nouveau contrat social entre citoyens et pouvoirs publics. La confiance constitue la clé de voûte de ce pacte, nécessitant transparence, stabilité et lisibilité des politiques publiques.
Les changements fréquents de dispositifs, avec pas moins de cinq versions différentes de MaPrimeRénov’ depuis sa création en 2020, créent une insécurité juridique peu propice à l’engagement des ménages. Une programmation pluriannuelle des aides, avec des trajectoires claires et prévisibles, permettrait aux acteurs de se projeter dans la durée.
L’implication citoyenne représente un levier encore sous-exploité. Des initiatives comme les ALEC (Agences Locales de l’Énergie et du Climat) démontrent l’efficacité d’approches participatives, où les habitants deviennent acteurs de la transition énergétique de leur territoire. Le développement de communautés d’entraide, à l’image des Castors dans l’après-guerre, pourrait constituer une réponse innovante aux défis actuels.
- Objectif de rénovations performantes annuelles d’ici 2030 : 700 000
- Nombre actuel de rénovations performantes par an : 70 000
- Potentiel de création d’emplois dans le secteur d’ici 2030 : 200 000
- Population touchée par la précarité énergétique : 12 millions
La transformation du système d’aides à la rénovation énergétique n’est pas qu’une question technique : c’est un projet de société qui engage l’avenir collectif et la capacité de la France à honorer ses engagements climatiques tout en garantissant un logement décent et abordable à l’ensemble de ses citoyens.